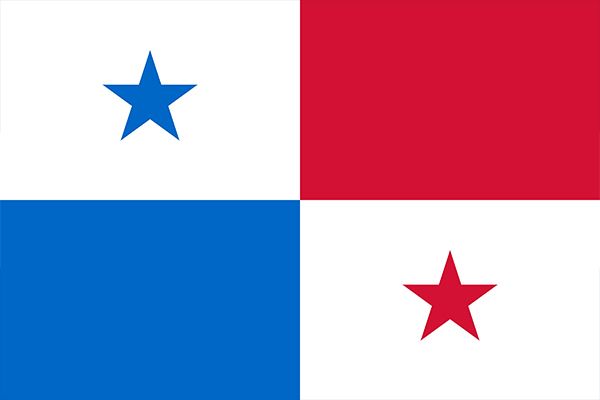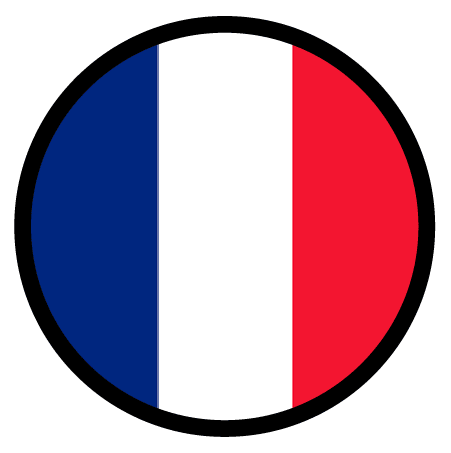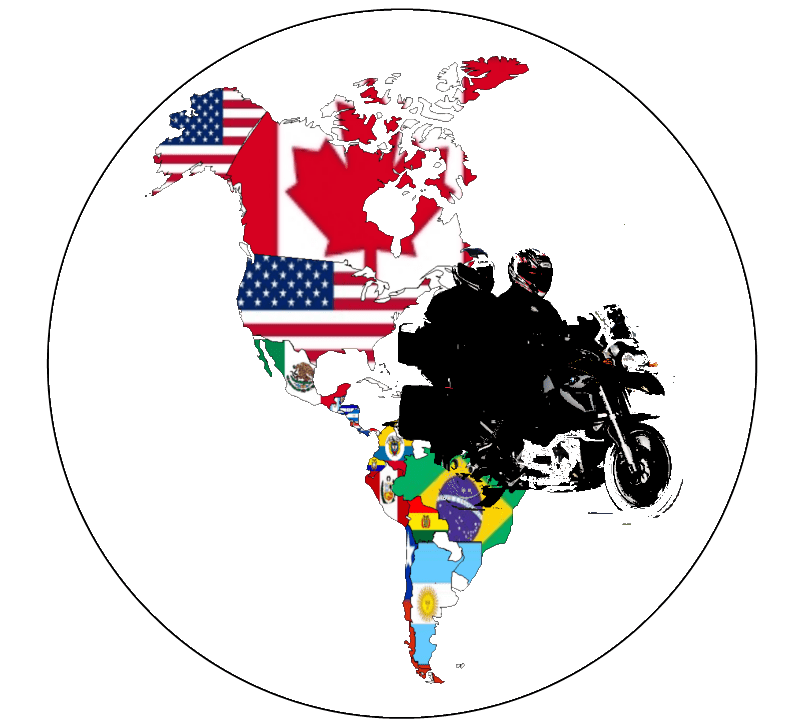GUATEMALA, témoins de Jova.
Aucun problème au passage de la frontière avec le Guatemala.
Je veille sur les motos pendant que les garçons remplissent les formalités d'immigration. Je suis abordée par un couple de français, voyageant avec un guide dans un gros 4X4. Leur coffre est rempli de valises. Ils sont très chics dans leurs habits de brousse. La femme me regarde avec les yeux ronds de surprise quand je lui raconte ma garde robe et que je lui dis crânement que, non le confort ne me manque pas tant que j’ai de l’eau, même froide, pour me laver. ! Sympa, elle me donne son flacon de Synthol quand je lui parle de ma récente chute et de mes douleurs.
Tous les papiers sont en règle et Laurent avait pensé à faire plusieurs photocopies.
Je me souviens d’un copain espagnol qui me faisait rire avec son expression : « Aller de Guate mala a guata peor » (traduire, « aller de mal en pis »)... Aujourd'hui je rigole moins, car la réalité « es peor » !
16 millions d'habitants au Guatemala. La moitié est d'origine Maya, répartis entre vingt trois ethnies, chacune avec sa langue et ses coutumes. 80% des guatémaltèques vivent sous le seuil de pauvreté. 55% des enfants souffrent de malnutrition. Ça calme !
Le crime et la corruption qui sévissent à tous les niveaux de l'Etat sont deux plaies que le gouvernement actuel ne sait pas gérer. Le pays est complètement désorganisé. Les gens font face, seuls, à des conditions de vie extrêmement difficiles.
Le temps est incertain...la route aussi, hésitant entre macadam et piste.
Nous allons à Tikal tandis que Joël trace jusqu'à Flores où nous le retrouverons demain soir.
Le site de Tikal en pleine jungle est la capitale du monde Maya. Des panneaux jaunes nous prédisent la rencontre avec de drôles de bêtes, jaguars et serpents. Prudence !
Il est 15h, le site ferme à 17h et comme il faut environ quatre ou cinq heures pour le visiter, on décide d'y aller plutôt le lendemain matin.
Le terrain de camping se résume à une grande pelouse gorgée d’eau et quelques dalles de béton sur lesquelles sont installés des palapas, on y monte la tente à l’abri de la pluie. Le gardien nous autorise à mettre nos affaires au sec dans son bungalow qui ferme à clé. Un peu plus loin, est stationné un petit 4X4 attelé d’une caravane. Incroyable ! Ce sont des savoyards ! Fabrice et Philippe. Comme nous, ils sont partis de Montréal, ont traversé le Canada jusqu'en Alaska, puis les USA et le Mexique et se dirigent vers Ushuaia.
Ils nous invitent à partager un plat de pâtes à la sauce tomate dans leur mini maison. Il y a de la bière dans le frigo et une bouteille d'alcool d'agave... On s'est marré toute la soirée ! Et il a plu à seau toute la nuit !
Au matin, nos nouveaux amis nous proposent un bon café au chaud et au sec dans la caravane. Trop sympa ! Ils reprennent la route, je croise les doigts pour quelle recroise la nôtre bientôt.
« Buena suerte les garçons ».
Bon ben c'est parti pour patauger toute la matinée dans la jungle, noyée sous un déluge.
Laurent s’est trouvé un poncho en plastique gris métallisé pour remplacer le Kway volé, c'est moche mais c'est mieux que rien.
Le site de Tikal, n'a été découvert qu'en 1948 au cœur d’une jungle inextricable. Certains temples ne sont restaurés que sur une ou deux faces, car c'est la végétation qui maintient les pierres en place.
Malheureusement, il pleut vraiment fort. Il est périlleux d'escalader les temples, car les hautes marches en pierre sont moussues et glissantes. Je les monte à quatre pattes et les redescends dos à la pente comme les enfants.
Même en grimpant l'un des plus hauts temples qui offre un panorama sur la jungle et tout le site, on ne verra qu'une brume épaisse qui étouffe les cris stridents des oiseaux et des singes hurleurs.
L'appareil photo, déjà bien abimé par deux chutes, la poussière de la route, et l'humidité, ne veut plus rien savoir. L'objectif sort difficilement même en tapant dessus et ne se referme plus...il n'y a pas que moi qui ai besoin d'être réparée.
Le temps ne s’améliore pas.
Après quatre heures à jouer les grenouilles, à sauter dans les flaques et patauger dans la boue, nous quittons le site et reprenons la route.
Nous rejoignons Joël à Flores comme prévu. On paresse dans un hamac humide sur le toit terrasse abrité de l’hôtel. Les draps qui sèchent sur la corde à linge claquent comme des voiles. Il ne fait pas très chaud. Un journal traine sur une table et attire mon attention. Les gros titres parlent de « Desastre nacional ». Nous sommes mi octobre et Jova, la tempête tropicale se déchaîne sur l'Amérique Centrale depuis quinze jours. C'est la saison des pluies au Guatemala, mais cette année est particulièrement gratinée. Villages dévastés, ponts emportés par les rivières boueuses…Waouh !!! Sur l’une des photos, le pont qu'on doit prendre pour aller au Salvador a disparu, emporté par les flots boueux. Ce qui n’est pas le plus grave, comparé aux milliers de sans-abris et aux centaines de morts.
Les journaux comparent Jova à Mitch et Stan, en 1998 et 2005, qui avaient également ravagé l'Amérique Centrale.
Dernière soirée avec Joël qui poursuit sa route et trace le plus rapidement possible pour rejoindre son frère en Bolivie.
Sur la route de Coban, situé dans la région montagneuse de l’Alta Verapaz, on prend la mesure du chaos. Beaucoup d'indiens mayas vivent dans des cases, au sol en terre battue, avec des murs de planches et un toit de palme, ou bien dans des cabanes en tôle ondulée.
On ne voit plus que des toits. Tout est engloutis. Les voitures sont noyées. Les gens s’organisent pour survivre. Dans les jardins inondés, ou même dans les fossés sur le bas côté des routes, les femmes en profitent pour faire la lessive. Surréaliste !
Elles étendent ensuite le linge sur les grillages et palissades.
Les petits enfants joyeux se baignent tout nus dans les champs, dans les fossés remplis d'eau ou devant leur maison inondée au milieu de détritus flottants.
Pas d'assurance, très peu d'aide de la part de l'État, qui de son propre aveu, reconnait n'avoir pas les moyens de faire face aux dégâts. Tout est trempé ou emporté par l'eau boueuse, et malgré ces calamités, les habitants restent stoïques, le regard grave, comme tous ceux qui n'ont pas d'autres choix.
Les femmes et les fillettes toujours tirées à « quatre épingles » avec leurs jupes plissées et leurs jolis caracos brodés, parcourent des kilomètres à pied chaque jour pour se rendre au marché. Elles en reviennent lourdement chargées de victuailles qu’elles portent souvent en équilibre sur la tête.
La vie est rude au Guatemala. Même les enfants bossent dur et très tôt. Nous voyons souvent sur le bord des routes, le père suivi de son garçon, portant sur leurs dos de très gros sacs de maïs, ou de bois, maintenus par une sangle posée sur leurs fronts. Ils marchent des heures penchés en avant, courbés sous le poids.
J'ai vu très souvent des gamins d’à peine 6 ans, machette à la main presque aussi grande qu'eux, défricher un lopin de terre. Á cet âge, les nôtres ont encore un petit couteau à bout rond à table. C’est bien sur totalement idiot de comparer, mais ce que nous voyons nous prend les tripes.
Notre « attelage » suscite toujours beaucoup de curiosité. Les visages graves s'éclairent d'un sourire lorsque nous leur faisons un signe de la main. Les hommes nous questionnent à propos de la moto et de la France. Et comme à chaque fois, un peu honteux, on ment sur le prix de la béhème.
Nous n’avions jusqu’à présent jamais vu une telle pauvreté, une telle misère sociale. Evidemment il y a peu de voitures individuelles. Ceux qui en ont les moyens, empruntent un « collectivo », minibus qui arrive souvent bondé, mais dans lequel il faut monter, coûte que coûte, sous peine d'attendre le suivant, pendant des heures. Parfois c’est un pick-up qui sert aussi bien à transporter les animaux et les matériaux que les gens, dans des conditions inimaginables.
Si la condition humaine est catastrophique, celle des animaux est aussi abominable. Chevaux efflanqués, blessures de bâts infectées, chiens galeux et affamés, « au secours Brigitte ! Quitte St Trop, y a du boulot par ici »
Nous devons traverser la rivière à Sayaxche avec un bac. La route s’arrête brutalement et on aperçoit un monticule de terre et de cailloux qui émerge à une vingtaine de mètres du bord. Le bac accoste sur ce confetti. Les camions et collectivos en descendent avec précaution et rejoignent la terre ferme dans de grandes gerbes d’eau. Je préfère monter à l’arrière d’un pick-up pour laisser Laurent effectuer seul la manœuvre. Je le regarde faire avec une pointe d’angoisse. Une fois tous les véhicules à bord, la barge s’éloigne. Le moteur poussif à bien du mal à lutter contre le courant. Il faut toute l’adresse du barreur pour arriver de l’autre côté.
L'état des routes est parfois excellent avec de magnifiques paysages de jungle, et parfois il manque des pans entiers de revêtement, emportés par les pluies diluviennes incessantes. Quand ce n’est pas toute la route qui s’est effondrée.
Il est impossible d’ignorer que l’Amérique Centrale est en pleine période d’élection présidentielle. Des slogans, de belles promesses, des sourires carnassiers, s’étalent sur les affiches, c’est la course à l’électorat.
J'espère juste que la réfection des routes fait partie de leur programme, car les gens en bavent, trimbalés comme des paquets sur les routes défoncées.
Comme il pleut encore on s'arrête deux nuits à Coban, dans un hostel, « la Casa Acuna ». Notre chambre au rez-de-chaussée sent un peu le moisi, mais la moto dort tranquille devant notre fenêtre.
L'établissement est aussi une pâtisserie réputée et un restaurant gastronomique ouvert sur un patio fleuri. On y prend de somptueux petits déjeuners au milieu des orchidées.
Il n'y a pas grand chose à faire ni à voir. Sur la place principale, trône un horrible kiosque orange et jaune en béton décati, de grandes trainées noires balafrent la façade blanche de l’église, les rues pavées et glissantes descendent à pic sur le marché. Dans les échoppes sombres et vétustes, on trouve vêtements traditionnels et sportswear, au milieu des cages à poulets et des étalages de fruits et légumes. L’eau sale rigole entre les pavés.
Il est habituel de manger dans la rue. Les gens se retrouvent en famille ou entre amis pour discuter assis sur un banc autour de la place principale. Et plus la soirée avance, plus on voit fleurir les petits étalages des femmes qui vendent ce qu’elles ont cuisiné toute la journée. Il a une longue file d’attente devant des étals. On se dit que s’il y a du monde c’est que c’est bon. Effectivement, nous nous régalons, mais on ne sait pas du tout ce qu’on a mangé. Quelque chose qui ressemblait à du poulet, cuit dans une feuille de bananier.
Nous avons envie de voir à quoi ressemble un site qui concourrait en 2008 pour la qualification de nouvelle « 8ème Merveille du Monde »: Semuc Champey.
Ce sont des cascades, et des piscines naturelles aux eaux couleurs émeraude et turquoise.
Et devinez quoi, la route qui y mène est un enfer. Avec les fortes pluies des dernières semaines, faut être sacrément motivé pour y aller.
Au début, tout va bien, pour moi. Une superbe route taillée à flanc de montagne, serpente au milieu de la jungle, de champs de maïs, de bananeraies, et de maisonnettes isolées.
Brutalement elle devient une piste qui descend sur 12 kms, de trous, de boue et de cailloux jusqu'au petit village de Lanquin, au fond d’une vallée perdue entourée de montagnes.
Il n’y a pas vraiment d’hôtel, juste une pension, ou des gens vivent en permanence. On s’y installe. La propriétaire nous dit de rentrer la moto dans la cour devant la porte de notre chambre. Un petit garçon joue avec des capsules de bières à même le sol, un autre veut que Laurent le photographie avec ses trois petits chiots. Les toilettes sont un trou nauséabond, sur lequel on rabat un genre de caillebotis lorsqu’on veut prendre une douche. L’eau jaillis d’un tuyau qui pend du plafond…Et malgré tout, je crois que c’est le top du confort dans ce village du bout du monde.
On saute dans un collectivo. Les gens sont entassés sur la plate forme débâchée. Comme nous sommes des gringos, nous avons droit à un traitement de faveur. Le chauffeur nous fait monter à l’avant. Dans le rétroviseur extérieur, j’aperçois des jambes qui pendent dans le vide, des mains crispées sur les barres en fer, et des visages sans expression. La piste qui mène à Semuc Champey n’est qu’une ornière de terre glaise collante. Le 4X4 lutte pour éviter l’embourbement. On est bringuebalé. Un vieux pont de bois et ferraille tenu par des câbles, enjambe une rivière qui charrie des troncs d’arbres déracinés.
C’est juste dix kilomètres qui en paraissent cent.
Nous finissons à pied sur un sentier en pleine jungle silencieuse, à peine troublée par les cris lointains des singes hurleurs. Nous longeons une rivière tumultueuse. Plus son lit devient étroit, plus elle devient furieuse. Soudain un trou béant dans la roche aspire le plus gros du débit et disparait sous terre pour ressortir 500 mètres plus bas. Mais en surface, son lit s’élargit et c’est une cascade de piscines naturelles aux eaux calmes et turquoise qui invitent à la baignade. Laurent est trop tenté, même s’il fait un poil frais et qu’il commence à pleuvoir. Moi qui ne suis pas très aquatique je l’attends sur un rocher, telle la petite sirène !
Pour le retour, nous préférons voyager à l’arrière du pickup…y a pas de raison !
Le lendemain aux aurores on se refait la route dans l'autre sens, vu qu'il n'y en a qu'une !
Il faut repartir sur Coban, pour prendre la direction d’Antigua, notre étape suivante via Guatemala City.
Mais à 140 kms de la capitale, un embouteillage monstre, qui doit durer depuis un moment, puisque des hommes jouent aux cartes entre deux camions, les femmes du village voisin apportent nourriture et boissons aux otages de la route. Nous remontons la file sur trois kilomètres jusqu'à l'origine du problème.
Et le problème, c’est un « derumbe » ! La montagne minée par les pluies incessantes a dégringolé. Les engins de déblayages sont déjà au travail, car c’est un axe routier important.
Une pelleteuse d'un côté, une chenille de l'autre, attaquent les tonnes de terre et de roches. On s’informe de la possibilité de traverser l’éboulement. Impossible, car au fur et à mesure qu’ils creusent, la montagne s’effondre. En aval, c’est la forêt, ronces et arbres couchés, pas question de passer par là avec notre grosse dondon ! Il est 11h30, le pronostique est la réouverture de la route vers 16h ...Bon ben on va attendre, puisqu'il n'y a pas d'autre voie praticable.
Les collectivos coincés de part et d'autre, s'organisent, et s'échangent les passagers. Hommes et femmes transportent tous leurs bagages et leurs paquets à travers la forêt ou escaladent le gigantesque éboulement. C’est très dangereux. Le temps passe. Finalement nous décidons de faire demi tour, persuadés que la route ne rouvrira pas avant 18 ou 19h et comme il fait nuit à 17h30, il est préférable de trouver un hôtel et tenter notre chance le lendemain car il n’est pas question de rouler de nuit.
Il n’y a plus qu'à croiser les doigts pour que le reste de la montagne ne dégringole pas.
Nous avons bien fait, car au petit déjeuner, nous apprenons que la route n'a été rouverte qu'à minuit.
« Allez, on y retourne ...faut que ça passe maintenant ».
L’eau la Terre et le Feu
Il est 9h, les pelleteuses ont bien travaillé, un passage boueux est dégagé et nous roulons sur une file.
L'état des routes est très, très mauvais, aggravé par les éboulements, et les pluies diluviennes, qui font toujours la une des quotidiens.
Nous roulons prudemment. J’observe les éboulis avec anxiété, j’ai peur que la montagne nous tombe dessus. Les journaux relatent tous les jours, de terribles accidents de voitures précipitées dans les ravins par des coulées de boue. On slalome sur la route en évitant de grosses pierres qui font office de cônes pour signaler les affaissements de chaussée. C’est ainsi que nous arrivons finalement à Guatemala City. Mais nous ne verrons rien de la capitale réputée très dangereuse. Le taux de criminalité est l’un des plus élevé d’Amérique Centrale. Les gangs enlèvent des gens contre rançon et on ne peut même pas se fier aux policiers qui parfois n’en sont pas. Nous contournons la capitale en apnée par une sorte de périphérique encombré de vieux tacots pétaradants et des fameux « chicken bus », anciens School bus américains, bien repeints mais mal réglés. A chaque accélération, ils lâchent leurs gaz d’échappement dans un épais nuage noir. Pour perdre le moins de temps possible sur leur trajet, ils avalent et recrachent les gens presque sans s'arrêter, à grand renfort d'impérieux coups de klaxon.
Nous sommes surpris de voir que les motards, qui pour la plupart sont des motos-taxis, roulent avec un casque et un gilet noir sur lequel le numéro d'immatriculation est écrit en gros et en blanc. Le passager n’est pas obligé d’être casqué, mais deux hommes ne peuvent pas circuler sur la même moto ! Ces mesures ont été prises car de nombreux assassinats et règlements de compte, ont été perpétrés par des hommes en moto.
Pourvu que les policiers ne prennent pas mon appareil photo pour une arme de poing. Je regarde rêveuse les grandes pancartes publicitaires qui vantent la bière nationale « Gallo » dont le Slogan est, « 100% Guate » avec en photo, des jeunes gens branchés, style américain ! Pour le moment, on n’en a pas vu des comme eux !
Je suis impatiente de visiter la perle du Guatemala, Antigua une très belle ville coloniale, d’architecture hispanique, à l’ambiance cosmopolite. Elle est construite au pied de trois volcans, l’Agua, l 'Acatenango et le Volcan Fuego toujours en activité.
L'histoire de cette ville est surprenante. Elle fut la capitale du Guatemala de 1543 à 1776. Détruite presque entièrement par un tremblement de terre en 1773, le gouvernement fut transféré dans l'actuelle ville de Guatemala City. Cela provoqua un mouvement de résistance qui fut stoppé net par une loi qui déclara illégal de vivre à Antigua.
La ville fut donc abandonnée jusqu'au début du 20ème siècle, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, de nombreux monuments, notamment les églises, soient toujours à l'état de ruines.
Depuis elle a été déclarée Monument National en 1944 et classée UNESCO en 1979.
Aujourd'hui Antigua est une ville très touristique, qui attire les routards dans ses nombreux petits hôtels charmants et bon marché, ses restaurants et ses bars bondés dès que la nuit tombe. Des bâtiments délabrés abritent les chars de la procession de la semaine Sainte. Une fois par an, en avril, Ils défilent dans les rues recouvertes de fresques réalisées en pétales de fleurs.
Nous nous promenons sans but précis. Tout simplement pour nous imprégner de l’ambiance très particulière qui règne ici. Une partie est morte, anéantie il y a près de 300 ans, mais l’autre est pleine de vie. Des fenêtres en encorbellement protégées de jolies grilles en fer ouvragé percent les façades peintes d’ocres et de terre de Sienne de certains hôtels chics. Au-delà des lourdes grilles, on entrevoit le vestibule richement décoré qui ouvre sur des patios fleuris, qu’on imagine frais et reposants, loin du brouhaha de la ville. Toutes les rues d'Antigua sont entièrement pavées de pierres disjointes, et parfois manquantes. Les vieilles guimbardes sont soumises à rude épreuve. Rouler là dessus fait hurler les suspensions et tordre les carrosseries. Gare à la crevaison, car les espaces entre les pavés sont tellement parsemés de vis et de boulons en tous genres, qu'on pourrait ouvrir une quincaillerie.
Les femmes mayas en costumes colorés nous rappellent que la population indienne est prédominante au Guatemala. Elles sont partout. Marchandes ambulantes, elles portent de lourdes panières remplies de fruits sur leur tête, ou vendent des étoffes. Assises au milieu de leurs jupes, à l’ombre des murs décrépis, elles tissent, tricotent ou bavardent entre elles, un enfant endormi sur le dos.
Des hommes mendient. Certains amputés, montrent leurs moignons aux passants indifférents. Un homme, cul de jatte, installé dans une caisse à roulettes, en plein carrefour, tend sa vieille casquette aux conducteurs pressés.
La présence militaire est bien visible. De gros pick-up kaki, tournent en permanence en ville. Deux hommes debout à l’arrière scrutent les alentours, main sur la mitraillette, tandis que le troisième est à son poste devant la mitrailleuse. On commence à s’habituer à ces manifestations de force. Le problème de l’insécurité est récurrent et ce depuis notre arrivée au Mexique. Même les petites épiceries se protègent. Très souvent c’est à travers des grilles en fer qui séparent les clients du comptoir, que l’on fait ses emplettes.
Le marché, incontournable, est une telle débauche de couleurs et d’odeurs que je pourrais y passer des heures rien que pour le plaisir. Sur un étal qui vend des écharpes de football, et des sweat shirts, il y a cinq vieux combinés téléphoniques posés là. Ils ne sont pas à vendre, mais on peut acheter une conversation. Chez nous ça s’appelle une cabine téléphonique !
On se rend au dépôt de bus à côté du marché. Les « chicken bus » d'Antigua ont un charme fou. Anciens school bus américains, ils sont peints de toutes les couleurs à la manière des bus indous. Chaque conducteur apporte sa touche personnelle. Et ce matin, tel les cornacs avec leurs éléphants, ils procèdent à une toilette minutieuse. Grimpés sur les capots ils astiquent sans faiblir les moindres centimètres de carrosserie et de chrome, en les aspergeant de baquets d’eau. En revanche bien que rutilants, ces bus recyclés, n’en sont pas moins très mal réglés. Fumant et pétaradant ils roulent à tombeaux ouverts emmenant hommes, femmes et enfants vers un avenir incertain. Les gens qui sont très croyants s’en remettent à Dieu. Comme je les comprends ! Entre l'état du véhicule, l'état du conducteur et les tas de trucs sur la chaussée, voyager en bus est une aventure dont on ne sort pas toujours vivant. C’est pour cette raison qu’il y a souvent des stickers à l’effigie de Jésus, collés sur les carrosseries, avec parfois des inscriptions surprenantes, traduite il y en a une qui dit : « Si je ne rentre pas ce soir, ne soit pas triste, c’est que je suis avec Dieu », ça en dit long sur la ferveur religieuse des gens !
« Dit bébé, ça t'embête que j’en colle un sur la bulle de la GS juste au cas où ?!».
Pour passer trois jours à Antigua et explorer les alentours, nous nous sommes installés dans un petit hôtel simple et pas cher. Les chambres, sur deux niveaux, ouvrent sur un jardin intérieur. La moto est une personne à part entière qu’il convient de bien recevoir. Elle est garée entre les tables et les chaises du patio. Je crois bien que si ce n’était pas la nôtre, j’irai dire au réceptionniste qu’il n’est pas très agréable de prendre son petit déjeuner à côté d’une bestiole aussi sale !
Laurent pour le remercier du traitement réservé à sa belle, vole à son secours en lui configurant son ordinateur afin d’avoir un accès internet. Et le garçon tout heureux en a profité toute la nuit pour surfer sur le Web !
On prend la moto pour sortir de la ville et se rendre au pied du Cerro de la Cruz. Après une bonne heure de grimpette par un sentier escarpé, on arrive en soufflant comme des tuberculeux au sommet et profitons d’une superbe vue sur la ville avec en toile de fond le Volcan Agua.
Le lendemain, nous décidons d’aller voir de plus près le volcan Pacaya, à 40 kms d’Antigua. La route est jolie et s’élèvent doucement courbe après courbe. Il fait beau, et malgré la fraicheur du matin, on sent que la journée sera chaude. Brutalement, une odeur fétide nous rappelle à une dure réalité. Jetés à même les bas côtés sur plusieurs kilomètres, les déchets de la ville, s’entassent et pourrissent. Des bandes de chiens faméliques fouillent les ordures. Le village que nous traversons ensuite n’est qu’une immense déchetterie. Des enfants jouent au milieu des détritus dans l'indifférence générale. La voie principale fait place à une piste jonchée d’immondices. Nous faisons demi-tour, écœurés. Nous irons à Pacaya par la grande route.
Les volcans nous attirent, et l'Amérique Centrale est une vraie poudrière car beaucoup sont en activité.
Le Pacaya est l'un d'entre eux. Il est possible de monter assez haut sur ses pentes de lave. Il a été en éruption de 1998 à ...2010. Un peu long au tirage le pépère !
Les derniers kilomètres avant le départ du chemin de randonnée sont taillés dans la lave. On traverse un petit village et des gamins se lancent à notre poursuite. On comprend vite pourquoi.
A peine garés, et seuls gringos à l’horizon, une nuée de jeunes nous rejoint essoufflés. Très pauvres, ils veulent tous gagner quelques quetzals en nous servant de guide. Un jeune insiste pour je monte sur l’un des chevaux fatigués qui attend en plein soleil. Il doit se dire que je suis bien trop vieille pour faire le chemin à pied ! Tous brandissent des bâtons de marche qu’ils veulent nous vendre. Ils sont agglutinés autour de nous et crient à qui mieux-mieux pour être choisi. Patiemment nous leurs expliquons que, non, nous ne voulons pas de guide, que nous ne monterons pas non plus à cheval…Mais ils sont tellement insistants que finalement Laurent pousse un coup de gueule et ça les calme. J’achète un bâton qui me sera bien utile mais j’ai du mal à leur faire comprendre que je n’en ai pas besoin de dix. Un homme dans une cabane de planche vend les tickets d’entrée sur le site. Un autre arbore un insigne de guide officiel. Nous n’y couperons pas, et c’est accompagné du bonhomme que nous grimpons pendant quatre kilomètres jusqu'au point le plus haut autorisé. Au loin, on peut apercevoir un versant de l'Agua, le volcan qui surplombe Antigua.
Il est assez difficile de marcher sur ses pierres de lave noire qui roulent sous les pieds, c’est surement pour cette raison que le jeune et son cheval ont décidé de nous suivre. A plusieurs reprises il me propose de monter dessus. Devant mes refus, de guerre lasse il abandonne, voyant que la « vieille » tient bien debout ! Á peine a-t-il tourné bride que je me casse la figure et me tord un doigt qui enfle immédiatement. C’est pô juste, c’est tout le temps moi qui me fait mal !
Le fameux café du Guatemala est cultivé sur les pentes fertiles des volcans...Maintenant qu'on a vu, on comprend l'importance du commerce équitable.
Plus nous approchons du cratère, plus la maigre végétation disparait.
Partout autour de nous des fumerolles s'échappent des crevasses de lave durcie.
Nous descendons dans une sorte de grotte envahie de vapeur d'eau, le guide explique que, les infiltrations des dernières pluies provoquent le phénomène en entrant en contact avec la lave.
Ça laisse rêveur mon homme qui, pour la première fois, met les pieds dans un hammam et sur un volcan.
Et puis surtout, nous étions seuls dans ce paysage lunaire, aux roches torturées. Le magma refroidi et craquelé ressemble à un gâteau noirci oublié dans le four.
Durant cette marche, mon bâton à la main, je me sentais si bien, au rythme de la nature, calme, en réflexion avec moi-même que j’ai su qu’en rentrant je partirai sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les préparatifs de ma future marche occupent toutes mes pensées pendant la descente.
De retour en ville, je décide de faire quelques emplettes sur le marché. J’ai repéré un joli sac besace en patchwork multicolore. Je vais pour retirer de l’argent au distributeur, mais impossible de mettre la main sur ma carte bleue. Je la cherche partout et soudain je réalise que contrairement à ce que je pensais, elle n’est pas dans le portefeuille de Laurent avec celle du compte joint, mais qu’elle devait être dans ma sacoche volée au Bélize…Il y a dix jours. Un grand vertige me prend, je m’affale sur le lit et à ce moment là, je suis sûre que je n’ai plus un sou sur mon compte. Je supplie Laurent de vérifier sur Internet l’état de mes finances… Ô miracle il ne manque pas un centime et aucun achat suspect n’a été effectué. Je m’empresse de contacter ma banque par mail pour qu’elle fasse opposition. Ça n’a pas été simple, mais on y est arrivé.
Notre prochaine étape est le Lac Atitlan. De nombreux d’éboulements coupent les routes, et notre progression est lente. Et toujours des femmes, des hommes et des enfants qui marchent le long des routes, courbés sous le poids de lourds fagots de bois, de parpaings ou de sacs de maïs. Et toujours ces chiens errants plus morts que vifs et des villages perdus accrochés aux flancs des montagnes.
Les grandes affiches de propagande présidentielle ont disparu, la tendance ici c’est de peindre les rochers aux couleurs des différents partis. La route est bordée de champs de café et d’avocatiers. Je n’en peux plus de la piste interminable et défoncée qui mène au bord du lac…Et au bord de mes limites. Surtout que la route est en cul de sac et qu’il faudra tout refaire le lendemain. Je pique une crise, descends de la moto et décide de marcher jusqu’au village. Je laisse Laurent tenter de contrôler sa colère qui monte. Et je marche. Au bout d’un quart d’heure, je vois arriver une voiture en face de moi, le gars ralenti, et me regarde éberlué. Faut dire, que tomber sur une fille aux cheveux courts et blancs, en blouson et pantalon de moto avec un casque à la main, au milieu d’un chemin de terre, c’est pas banal. Trois minutes après, Laurent qui m’avait laissé partir devant me rattrape en me disant de remonter en selle illico, si je ne veux pas me faire dépouiller. Récemment des touristes ont été attaqués sur cette route…Enfin, c’est ce que lui a dit le gars en voiture ! On apprendra plus tard, qu’il est fortement recommandé de se faire escorter par la police sur cette portion de piste… Comme quoi, quand on ne sait pas, ben on ne flippe pas !
Le Lac Atitlan est entouré de volcans, et de villages indiens Zutuhils, d'une ethnie différente de celles que nous avons déjà rencontrées. Les hommes portent un chapeau de paille finement tressée, un bermuda rayé bleu marine et blanc. Certains sont rebrodés, peut être des hommes mariés ?
La montée des eaux du lac a noyé une partie de la ville. Les palmiers ont les pieds dans l’eau, on ne voit plus que les toits de palme des palapas. Les canots à moteur sillonnent toute une partie de la ville au milieu des enfants qui barbotent, le mobilier urbain leur servant de plongeoir improvisé.
Les femmes remontent leurs jupes et participent à une joyeuse séance de lessive collective.
J’ai l’impression que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Ce sont elles qui vendent sur le marché, cuisinent sur des réchauds ou des barbecues portables à même le trottoir pendant que les hommes discutent assis sur un banc.
Nous ne croisons aucun étranger. Dans le petit hôtel du centre, il n’y a que nous. La moto est dans l’entrée au pied de l’escalier. Il a fallu mettre une planche pour monter le trottoir et rentrer dans le couloir en une seule fois. Gazzz et chaud devant, ça passe juste. Garer la moto à l’intérieur de l’hôtel n’est jamais un problème et neuf fois sur dix, c’est l’hôtelier qui nous le propose.
Notre chambre donne sur les toits de tôles. Enchevêtrement de courettes en terre battues, et de pauvres maisons en parpaing ou poules et cochons cherchent leur pitance au milieu des épluchures. En toile de fond, un volcan tombe à pic dans les eaux du lac. De la fenêtre j’observe un enfant, grimpé sur le toit de sa maison, qui joue au cerf-volant. Un joli moment d’évasion.
Nous sortons dîner dans un petit restaurant. Pas de façade, un simple store roulant en fer rouillé protège l’établissement la nuit. Sur les marches, une vieille femme est assise au milieu de ses jupes, un gros ballot recouvert d’un tissu bariolé sur les genoux. Elle marmonne en silence. Le regard un peu vague elle nous gratifie d’un sourire édenté en penchant légèrement la tête. On n’a pas très faim. Un plat de poulet frit avec du riz fait l’affaire. Je n’ai pas vu arriver la vieille femme. Profitant de l’absence de la serveuse, d’un geste vif elle chipe mes os de poulet, qu’elle fait disparaitre prestement sous ses jupons, tout en posant un doigt sur sa bouche, m’intimant le silence. En deux pas, elle a reprit sa place sur les marches. Ça n’a duré que quelques secondes, mais ça m’a tellement choqué. J’ai la gorge serrée. Nous lui achetons de quoi manger un peu ce soir...Une goutte d'eau dans un océan.
Nous continuons notre traversée du pays en direction du Salvador. Sur la route d'Escuintla, un groupe de motards en hyper-sports flambants neufs, nous doublent comme des missiles sol-sol. On se dit qu'ils sont sacrément gonflés, vus les énormes trous sur la route, profonds de plusieurs dizaines de centimètres. Laurent roule prudemment et ne cherche pas à suivre la meute. Ce qui me convient parfaitement.
Déjà qu’à 90km/h en GS c'est slalom géant mais à 160km/h, c'est la roulette ...Guatémaltèque. Et à ce jeu là, il y en a qui ont perdu le contrôle. Le groupe est arrêté, quelques kilomètres plus loin. Deux des leurs sont dans le fossé, motos détruites. Ils sont passés à deux doigts d’un pylône en béton.
Etrange contraste culturel et social entre cette vieille femme qui attend les restes de mon repas et ces jeunes cons friqués, qui, un dimanche après midi, se permettent de planter leur GSXR dernier modèle, en roulant comme des fous sur une route défoncée !
Dans ces pays, la signalisation est souvent approximative. Malgré que nous ayons une carte détaillée, il arrive que nous demandions notre chemin, ou bien juste une confirmation que nous sommes sur la bonne route. C’est là que les ennuis commencent. Le premier réflexe est de demander à des policiers ou des militaires. Mais on se rend vite compte qu’ils ne savent pas se situer sur une carte. Ils la tournent dans tous les sens sans pouvoir s’orienter. Et quand Laurent s’arrête pour demander à un passant si c’est bien par là la route de machin, invariablement la personne répond « oui » même si elle n’en sait rien. Les gens ne veulent ni décevoir, ni montrer leur ignorance. Pour obtenir une réponse efficace mieux vaut reformuler. « Quelle est la route qui va à… ? » Et non « Est-ce bien la route qui va à… » Et toujours interroger une seconde personne. Ça parait subtil, mais ça fait toute la différence et on s’évite des demi-tours et des kilomètres inutiles.
Nous approchons de la frontière du Salvador, les infos sur la possibilité de passer sont contradictoires. « Bon ben on verra bien ». Effectivement, ça ne passe pas partout ! La rivière en crue a emporté les piles du pont qui s'est effondré.
Cela nous oblige à faire un grand détour, et la journée est trop avancée pour envisager de passer la frontière. On se trouve un petit hôtel tranquille à Jalpatagua, pour notre dernière nuit au Guatemala. Encore une fois nous sommes seuls, bien loin des circuits touristiques. Le propriétaire se met en quatre pour nous, la moto est garée sous le préau, dans le restaurant. Il nous sert un excellent diner au bord de la piscine. Mais l’eau est tellement trouble et sale que malgré la chaleur je renonce à l’envie de piquer une tête.
« Les gens qui ne vivent pas comme nous ne sont pas obligatoirement malheureux ». C’est ce que je me suis répété tous les jours depuis l’entrée au Guatemala. Et malgré des conditions météo un peu difficiles nous avons vraiment craqué pour ce pays chaleureux, qui avance... Á petits pas. Les guatémaltèques espèrent que le futur gouvernement aura la poigne nécessaire pour mettre le pays sur la voie de l'évolution.
SALVADOR/HONDURAS/NICARAGUA
Migration de motards vers le Sud
Sortir du Guatemala ne pose aucun problème. Les formalités sont simples.
Sortie du pays, passage au bureau des douanes pour faire viser le certificat d'importation temporaire de la moto. Passage à l'immigration pour les passeports, on traverse le pont et la même chose de l'autre côté pour entrer au Salvador. Tout ça prend quand même deux bonnes heures. Ce qui m’amuse c’est que je n’ai même pas besoin de me déplacer pour les formalités, Laurent fait tamponner les deux passeports tandis que je reste près de la moto.
Notre objectif étant de traverser rapidement l'Amérique Centrale, jusqu'au Panama, on n'a pas trop traîné sur la route.
Juste le temps d'admirer les jolies plages de sable noir des spots à surfeurs. Tranquillement installés au bar de la plage, on les regarde marcher en se dandinant sur les galets, leur planche sous le bras.
Les plages sont nettoyées devant les hôtels, mais au-delà, elles sont jonchées de bois flottés que de vieilles femmes ramassent pour allumer le feu de leur cuisinière.
Assise sur un tronc blanchi, je regarde le soleil se coucher sur la mer dans un joli dégradé de rose. Des enfants courent sur la plage et Laurent s’est décidé à piquer une tête dans les rouleaux d’écume. Nous dinons dans un petit restaurant à ciel ouvert, et finissons la soirée à discuter avec Dan, un américain jovial qui vient surfer ici un mois par an depuis 20 ans.
Le soleil est revenu comme par magie. La chaleur et le taux d’humidité augmentent peu à peu. Nous reprenons la route, vers San Miguel et le volcan du même nom.
Après le Guatemala, ce que nous voyons du Salvador nous parait bien américanisé ! Beaucoup plus de voitures individuelles et de grandes enseignes, Coca, Mc Do, KFC donnent l’illusion d’un certain niveau de vie, du moins en ville. Mais il ne faut pas s’y fier, le Salvador est le pays le plus dangereux d’Amérique Latine. C’est pour cette raison que nous évitons soigneusement les coins qui craignent le plus.
Très vite, nous quittons le Salvador, pour entrer au Honduras. Le poste frontière est quelque peu folklorique. Beaucoup de petites casemates de tôle abritent divers commerces. Des nuages de fumées noires s’échappent des pots d’échappements des gros camions qui laissent tourner leur moteur pendant les formalités de douanes. Il règne une effervescence moite et poussiéreuse. J’attends près de la moto tandis que Laurent se fraye un chemin au milieu d’une foule bigarrée. Je le vois disparaitre sous l’immense halle de béton où commence le parcours du combattant. Trouver le bon gars qui a le bon tampon ! Fournir les innombrables photocopies des différents documents administratifs d’entrée et de sortie de territoire. Puis attendre la fouille des bagages et la fumiginisation de la moto ! Procédé fumeux, c’est le cas de le dire, qui consiste à pulvériser un produit désinfectant sur les véhicules. Je crois que ça leur permet surtout de nous soutirer quelques dollars !
La traversée du Honduras est encore plus rapide. Cent kilomètres dans sa partie la plus étroite, juste le temps d’apercevoir trois maisons et des femmes qui font leur lessive dans la rivière pendant que les enfants se baignent. Il fait une chaleur étouffante et nous faisons une pause en ville pour acheter de l’eau. Je me demandais d’où pouvaient provenir les milliers de petits sacs plastiques jonchant le sol. En fait ils contiennent l’équivalent d’un verre d’eau et une fois bus, les gens les jettent par terre. On trouve de tout sur le sol, même une plaque minéralogique toute cabossée que je m’empresse de ramasser et qui ira rejoindre notre collection.
Nous sortons du Honduras et entrons au Nicaragua dans la même journée. Dur dur pour les nerfs !
Deux kilomètres avant la frontière, un gars en tee-shirt et casquette, brandissant un badge qui a l’air officiel, nous fait signe de stopper. Deux minutes plus tard, un motard, que nous n’avions jamais rencontré, s’arrête à côté de nous. Jarek est polonais, il habite Boston et voyage seul sur sa BMW1150GS. En fait le gars nous explique que l’assurance pour entrer au Nicaragua est obligatoire et une jeune femme nous fait remplir un document. Nous repartons jusqu’au poste frontière et nous sommes suivis de près par deux gars sur un pétarou. Des hordes de types nous assaillent toujours aux frontières en nous proposant leur aide pour les formalités de douanes. Ils nous disent que sans eux, on n’y arrivera pas, car il faut s’adresser à plusieurs guichets dans un ordre connu d’eux seuls. Je soupçonne même certains d’être de mèche avec les officiels, car à la clé il y a toujours un peu d’argent à se faire. En parallèle, d’autres nous agitent de grosses liasses de billets sous le nez pour le change. Tous se veulent « officiels » et nous montrent une carte qui l’atteste. Nous déclinons toujours avec le sourire et un « no gracias » sans équivoque puis nous les ignorons et en général ils abandonnent la partie assez vite. Mais aujourd’hui, les deux mecs à la moto sont assez agressifs en voyant leur pourboire leur échapper. Restée seule près des motos, j’affiche un air tranquille et dégagé que je suis loin de ressentir, lorsqu’ils me crachent des insultes au visage. J’ai hâte de voir Laurent et Jarek ressortir des bureaux.
Nous décidons de faire la route ensemble jusqu'à Leon. A part quelques vélos, il y a très peu de circulation. Nous faisons du slalom entre les trous béants sur la chaussée. Une semi-remorque s’est couchée en contrebas de la route, il y a un tel dénivelé qu’elle est presque invisible. Nous nous arrêtons et Laurent entreprend de dévisser la plaque d’immatriculation. Grand mal lui prend, surgissant de nulle part, un gars, à priori le conducteur, arrive droit sur nous en vociférant téléphone portable collé à l’oreille en ligne avec la police. Il n’apprécie pas du tout de se faire voler sa plaque. Le camion est dans un tel état qu’on croyait que c’était une épave accidentée depuis longtemps. Pas vraiment ! Après s’être confondu en excuses, Laurent la revisse et nous repartons penauds.
Les champs alentours sont inondés, ici aussi, la tempête tropicale Jova a fait des ravages. Au loin une chaine de volcans se découpe sur un ciel délavé.
Nous entrons dans Leon en fin d’après-midi. Leon est une jolie ville et ses fresques murales rappellent les heures sombres du Nicaragua entre les Sandinistes et les USA qui ne voyaient pas d'un bon œil le communisme se rapprocher de leur frontière. La jeunesse dynamique, tourne le dos au passé. Le Nicaragua, malgré son classement dans les pays les plus pauvres du monde, avance.
Comme d’habitude, à peine arrivés en ville, nous sommes à la recherche d’un hôtel, en centre ville, pas trop cher, et dans lequel on puisse sécuriser la moto. Nous tournons dans les rues, et on voit un grand mec, blond qui nous fait signe. Kerman est français et voyage en DR 650 Honda. Il nous indique un hôtel où nous avons la surprise de retrouver Nick et Ivanka, les anglais en 1150GS, rencontrés en juin en Alaska sur la Dalton Highway tout près du cercle polaire.
Bonne surprise aussi de revoir Glenn et son KLR avec qui nous avions passé une sympathique soirée à Palenque au Mexique en septembre.
Ils font la route ensemble avec un couple d'australiens Mark et Maggie, en 1150GS en voyage depuis trois ans. Leur hôtel est un peu cher du coup, nous nous installons dans celui d’en face. Le matelas est mince et sent le pipi de chat. Je l’asperge d’huile essentielle de lavande, il parait qu’en plus ça chasse les poux. Je ronchonne car il n’y a pas de fenêtre, Laurent lui constate qu’effectivement ça ne sent pas très bon mais que ça ira bien pour une nuit.
Nous passons une joyeuse soirée et savourons le récit des aventures de chacun. Jarek sort de son sac un drapeau polonais qu’il fait signer aux motards qu’il rencontre. Mais quelle bonne idée ! Comment n’ai-je pas pensé à ça ? Si je n’ai pas de drapeau, j’ai un tee-shirt imprimé « trans’am2011 ». Je m’empresse de lui piquer sa bonne idée, et commence ma moisson de dédicaces de motards voyageurs.
L'Amérique centrale est le goulet qui oblige tous ceux qui vont du Nord au Sud, ou inversement à emprunter quasiment le même itinéraire.
Le matin à 8 h, il règne dans la rue une agitation inhabituelle. Cinq grosses cylindrées, huit motards et des kilos de bagages à arrimer.
Nick regarde perplexe tout son barda étalé à l’ombre sur le trottoir. « Ben oui Nick, tout est à toi et doit tenir sur la moto !».
La caravane s'ébranle vers 10h30 à travers les rues de Leon.
Jarek et nous prenons la direction de Granada tandis que les autres s’arrêtent à Managua. Il est prévu de nous retrouver dans deux jours pour diner ensemble. L’étape est courte, on en profite pour s’arrêter voir de près le cratère du volcan Masaya. Quand je dis près, c'est très près ! La route mène directement au bord du cratère. Des inscriptions au sol préconisent de se garer de façon à pouvoir déguerpir le plus vite possible en cas d’éruption…Je ne suis pas sur que ce soit suffisant pour en réchapper.
De même il est recommandé de ne pas rester aux abords plus de trente minutes, à cause des vapeurs soufrées. Un chemin de ronde à peine sécurisé, suit le pourtour du vertigineux cratère, et nous essayons d’en apercevoir le fond. Masqués d’un bandana, nous jouons les Haroun Tazieff amateurs pendant plus d’une heure. Tout simplement extraordinaire !
Á Granada nous trouvons un hôtel dans une belle bâtisse vieillissante. L'hospedaje Esfinge est en plein cœur de la rue la plus commerçante de la ville, face au marché.
Construite en 1903 ce fût la demeure d'un fameux Général du Honduras en exil dont j'ai oublié le nom. Il est tenu aujourd'hui par ses descendants. D’un charme désuet, sous le haut plafond du hall d’accueil, un vieux juke-box des années 50 côtoie des faïences exposées dans une vitrine de bois blond. Yarek et Laurent ont déjà pris possession des rocking-chairs qui invitent à la détente loin du brouhaha du marché. Les pales d’un vieux ventilateur brassent l’air chaud.
Les chambres individuelles sont minuscules, mais trop jolies, peintes à la main de trompes l’œil un peu naïfs et colorés.
Nous partons à la découverte de la ville en fin de journée. Un ciel plombé éclaire les bâtiments aux façades coloniales d'une lumière métallique. Nous retrouvons Kerman à son hôtel situé dans la partie touristique de la ville. Il est accompagné de Delphine et Cédric un jeune couple de belges voyageant en vélo ! On s’installe en terrasse pour boire un verre et faire connaissance. Nous sommes bientôt rejoins par Jarek qui repart dès le lendemain matin aux aurores, et deux australiens en KLR qu’Herman a rencontré au Guatemala. Nous terminons la soirée au restaurant et je sympathise avec mes voisins francophones. Ils ont commencé leur voyage à Cancun et descendent en Terre de Feu chacun sur leur vélo. Enfin, comme dit Delphine, « si on y arrive ». Je suis admirative. Delphine, de son propre aveu, n'est pas sportive, et n'aime pas le vélo « plus que ça !». Elle voulait juste accompagner son mari. En tous cas, bravo ma belle, sacrée aventure.
Le lendemain, du groupe, Glenn est le seul à venir s’installer dans notre hôtel, ses compagnons de route ayant préféré poser leurs valises ailleurs. Nous profitons d’une connexion internet, pour terminer la mise en ligne du dernier article. Je laisse Laurent chez le coiffeur, prendre place courageusement dans le fauteuil d’un barbier, armé d’un coupe-chou. Après avoir regardé (en espagnol) Sweeney Todd, le Barbier de Fleet Street, campé par un Johnny Deep qui égorge tous ses clients en chantant ! Je le trouve un peu téméraire !
_« A tout à l’heure, bébé, je vais rejoindre Glenn sur le marché, bonne chance !».
Le soir nous retrouvons Mark & Maggie, Nick & Ivanka, Kerman, Glenn, les australiens Tim et son copain Adrian, Delphine et Cédric pour un dernier diner entre voyageurs.
Le lendemain matin, le gardien de nuit de l’hôtel pose fièrement à côté de la moto, chargée comme une mule prête à avaler les derniers kilomètres qui nous séparent du Costa Rica. La patronne qui adore Laurent, lui demande d’adresser un commentaire positif sur son Hôtel, au guide Lonely Planet. A la différence d’autres établissements situés dans la zone touristique, et tenus par des étrangers, elle n’est pas référencée, car son hôtel est juste en face du marché réputé dangereux. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous nous y sommes arrêtés. On évite les hôtels à backpackers des guides, souvent plus chers et bondés que les hôtels tenus par des locaux, et dont la clientèle est plus authentique. « Promis madame on va leur écrire ».
Il est 9 h nous partons.
Une demi-heure plus tard, d’un coup de gaz, nous doublons nos cyclistes belges partis depuis 7 h du matin, debout sur leurs pédales. « C'est pô juste ». On s’arrête pour leur faire un bisou et leur souhaiter bonne route, car nous ne les reverrons plus.
Pour nos derniers kilomètres au Nicaragua, nous avons en toile de fond les volcans de l'ile D'Ometepe.
COSTA RICA/PANAMA
De la jungle du Costaricaine au canal de Panama.
Nous sommes contents d’arriver au Costa Rica. C’est vrai qu’on en attend beaucoup. Il y a tellement de reportages qui vantent la faune et la flore, qu’inévitablement on s’imagine qu’on va traverser le paradis terrestre.
Mais la route du paradis est semée d’embûches et ça commence dès la frontière à la sortie du Nicaragua. La pire de toutes. Il y a déjà deux motos garées, lorsque nous arrivons. Laurent s’engouffre dans les bureaux de douanes et je vois sortir un garçon roux. C’est ainsi que nous rencontrons Jess et Jessica, un couple de motards canadiens. Pour le moment, comme nous ils sont en galère dans le capharnaüm qu’est cette frontière entre Nicaragua et Costa Rica. Jess roule en Kawasaki Versys, Jessica en 650SV Suzuki. Jess et moi faisons vite connaissance et papotons comme des potes pendant que nos conjoints respectifs se dépatouillent des tracasseries administratives. Jessica, d’origine Salvadorienne, parle espagnol, ce qui lui facilite bien des choses. Malgré tout, ça dure des heures avant que nous puissions repartir. Il n’y a pas que pour nous que c’est long et compliqué, vu le nombre de camions en attente. Amusée, j’observe un chauffeur poids-lourd faire une sieste dans son hamac, tendu à l’abri de la pluie sous la remorque, ses chaussures posées à côté.
Quand je vois Jessica monter sur sa moto, alors là, je suis scotchée ! Elle fait 1m55, elle a 1 an 1/2 de permis, sa moto est chargée comme un mulet, et ils arrivent de l’Ontario. Quand je pense à tous les kilomètres de routes et de pistes épouvantables qu’elle a déjà fait pour arriver jusqu’ici…
Je suis verte de jalousie !
« Je te tire mon chapeau ma grande, t’es trop forte !».
En fait nous avions entendu parler d'eux par Kerman, qui les avait rencontrés sur une route défoncée du côté de Lanquin au Guatemala, Tu penses si je m’en souviens de cette route…
Nous avons perdu beaucoup de temps à la frontière, le ciel est chargé et comme tous les soirs il va certainement pleuvoir. Jess propose d’ouvrir la route avec son GPS. Laurent préfère lire sa carte, et devinez qui a raison…Ah la technologie moderne, ça ne vaut rien ! Au bout d’une trentaine de kilomètres, on s’est rendu compte qu’à la dernière bifurcation, il fallait continuer tout droit au lieu de tourner à droite. Du coup c’est mon homme qui prend la tête du cortège pour récupérer la bonne route.
Il est 17 h, nous décidons de nous arrêter dans un bled perdu pour la nuit qui commence à tomber. Passer des frontières ensemble, ça crée des liens ! Aussi nous n'hésitons pas une seconde à partager la chambre d’hôtel. Une chambre à deux grands lits est plus économique que deux chambres doubles. Eh oui le Costa Rica est bôôcoup plus cher que les autres pays d'Amérique Centrale.
Les Jess’s qui, quelques heures plus tôt n'étaient encore que de parfaits inconnus dormiront dans le lit d'à côté. Entre leurs bagages et les nôtres, les casques, blousons et godasses, ça sent un peu le fauve dans la tanière. Voyager, c'est partager ! Nous nous découvrons un autre point commun, eux aussi se sont rencontrés sur Internet… Comme quoi, un petit clic peut mener très loin…
Une fois les motos garées en étoile et sécurisées, les trois roues avant cadenassées ensemble, nous dînons dans un restaurant local self-service.
Au matin nous prenons la route à travers le pays. Le ciel est bas, les nuages gonflés d’humidité. Nous passons au pied du Volcan Arenal, sans le voir. Une brume épaisse nous enveloppe tandis que nous roulons au milieu d’une jungle luxuriante. Ici pas de cahuttes en tôle, ni de maisonnettes en plastique tenues par des planches, c’est plutôt, villas, piscine, hôtel de luxe et jardins d’Eden. Les américains ont beaucoup investi au Costa Rica. Stabilité politique, préoccupations écologiques et situation géographique idéale entre deux océans, ont attiré les investissements étrangers, à tel point, que les prix ont atteint des sommets qui pénalisent les Costaricains.
Direction le parc national de Tortuguero situé sur la côte caraïbes. Comme les Jess’s vont au même endroit, nous préparons ensemble un petit programme de découverte de la faune et la flore. Nous avons pris deux chambre dans un hôtel à Cariari, qui accepte de nous garder les motos pendant nos deux jours d’absence. Les guides sont nombreux à vendre des circuits et pour $ 20/personne, nous faisons affaire avec l’un d’entre eux. C’est incontournable car le Parc Tortuguero n’est pas accessible par la route. Á 6 h le lendemain matin nous nous rendons à la gare routière pour le transfert en car jusqu’à l’embarcadère. De là, on monte dans une lancha qui sert de minibus aux habitants de la mangrove. Les gens montent et descendent à chaque arrêt et les enfants se rendent à l’école. Vers 10h, nous arrivons dans le village. On a juste le temps de déposer nos affaires dans un bungalow sur la plage, qu’il faut déjà sauter dans une autre barque avec le guide et partie à la découverte des habitants de la jungle. Pendant plus de trois heures nous sommes à l’écoute du moindre souffle de vie. La barque glisse silencieusement sur les eaux noires des canaux. On scrute la végétation tropicale, dans l’espoir de surprendre les animaux dans leur habitat. Tortues, bébés caïmans aux yeux globuleux, iguanes vert, oiseaux multicolores, singes et papillons bleus métallisés géants, il faut juste avoir l’œil et un bon téléobjectif. Notre appareil photo agonise. L’objectif sort difficilement dans un grincement sinistre et les ailettes de protection ne s’écartent plus. Les passagers me regardent d’un air réprobateur et Jessica pouffe de rire. Heureusement qu’il reste le vieil appareil de Laurent pour nous dépanner. Malheureusement il n’est pas aussi performant. Au final Jess nous promet de nous donner ses photos. Le village de petites maisons de bois aux tons pastels construites sur pilotis, s’étend sur le bord d’une plage de sable blanc face à la mer des Caraïbes. Les tortues viennent y pondre leurs œufs et nous avons l’incroyable chance d’assister à la naissance de dizaines de bébés tortues.
L’expérience est unique et très émouvante. Nous sommes émerveillés. On les regarde émerger du sable et foncer vers la mer de toute la force de leurs petites pattes en forme de pales qui tournent comme des hélices. Elles ne tentent l'aventure que lorsque que le soleil est couché, car la chaleur du sable brûlerait leur fragile carapace.
Les chiens errants sont aussi un véritable danger pour elles, car ils creusent les nids, déterrent les œufs et les mangent. Ils les dévorent aussi lorsqu'elles courent sur le sable pour rejoindre la mer. Dure loi de la vie !
Le lendemain, nous quittons nos compagnons de route, ils veulent faire du raft, et nous, nous devons allez à San José, la capitale. Il faut absolument faire réparer l’appareil photo ou en racheter un nouveau et peut être trouver un nouveau sac de couchage.
San José, n’est pas une ville très intéressante ce sont les USA sous les tropiques. Grandes artères, grandes concessions automobiles de marques européennes, américaines et japonaises, grands hôtels, grandes enseignes franchisées, et grandes galeries marchandes ultra modernes sur trois niveaux.
Ici aucun risque d'être dépaysé ou de marcher dans la boue, les motos BMW que l'on croise sont bien propres sur elles.
D'ailleurs, le Costa Rica n'est plus vraiment une terre d'aventure. Mais l'endroit idéal pour passer une semaine en hôtel club, avec minibus climatisé qui vous emmène faire une excursion à $90 en toute sécurité.
Il y a des costaricains à qui tout ce business ne plait pas trop, si l’on en croit les graffitis qui fleurissent un peu partout : « Le Costa Rica n’est pas à vendre ».
Faut dire que le bétonnage du littoral est en plein boom, au détriment des petits hôtels typiques qu'affectionnent les surfeurs du monde entier.
On a arpenté un immense centre commercial, et malgré la profusion de magasins, impossible de trouver un duvet à un prix abordable, quant à l'appareil photo, après un diagnostique à $20 il s'avère qu'il est irréparable, du coup nous sommes obligé d'en racheter un...plus cher...mais mieux. Enfin c'est ce que l'on croyait…
Le Costa Rica vit de son image de réserve naturelle. Et des animaux, nous en avons vu beaucoup. Un arrêt sur le pont de Tarcoles, nous permet d’observer sur les berges, de monstrueux crocodiles de rivière. Leur peau est claire, ils ont de grandes dents qui dépassent de leurs gueules, et de larges pattes griffues. On pourrait facilement les confondre avec des bois flottés tant ils sont immobiles. Ils semblent tous droits venus de la préhistoire. Leur garde-manger n’est pas très loin, quelques bêtes à cornes broutent tout près. Je me demande si une vache court plus vite qu’un crocodile ?
Avant de quitter ce joli petit pays nous visitons le Parc national « Manuel Antonio ». L’occasion de randonner, seuls sans guide, au milieu de la jungle, peuplée de singes capucins, aux visages renfrognés. Leurs mimiques sont très expressives et on s’amuse à les regarder, suspendus par la queue la tête en bas, essayer de chaparder la nourriture à des gens qui pique niquent sous les arbres. Les ratons laveurs, eux n’hésitent pas à fouiller les sacs laissés sans surveillance sur la plage par les baigneurs. Enroulé sur une branche au dessus du chemin, un boa fait sa sieste, enfin j’espère ! Des oiseaux par milliers donnent un concert dans la forêt.
En levant les yeux, on devine des paresseux eux aussi dans des poses acrobatiques se régaler de feuillages Quelques singes hurleurs, invisibles, un iguane turquoise de plus d’un mètre de long qui prend un bain de soleil allongé nonchalamment sur la branche basse d’un arbre qui pousse sur la plage.
Des sentiers glissants s’enfoncent dans la jungle. Moi je me méfie juste d’un truc, les araignées…C’est ma bête noire !
La flore tropicale est aussi très variée, colorée et surprenante. Je ne connais pas le nom des fleurs extraordinaires que l’on trouve sur le bord des routes, mais ce que je sais, c’est que certaines sont vendues très cher chez les fleuristes français !
Malgré la brume, les contrastes de couleurs sont magnifiques. Ciel plombé, vastes prairies verdoyantes, terres agricoles nues ou cultivées, forêts sombres, montagnes dont les sommets se perdent dans les nuages, c’est un pays extraordinaire, juste un peu trop « aseptisé » à notre goût.
On sort du Costa Rica plus vite qu’on y est entré.
En revanche, ce qui s’annonçait plutôt bien pour les formalités d’entrée au Panama, va se transformer en galère. Un américain sympa, un peu baba cool, qui a l’air de connaitre tout le monde ici, nous explique la marche à suivre. Quel guichet, quel officiel, les bons tampons, et le plus important, dans quel ordre.
En fait, pas de bol, on va y passer trois heures. La fille, pas futée, qui délivre le document de l'assurance obligatoire, s'est trompée dans les dates de validité. Et comme c’est l’heure de déjeuner, elle a fermé son bureau, et nous devons attendre son retour. On passe le temps, en assistant au spectacle d’une fête municipale. Joueurs de tambours et danseuses s'en donnent à cœur joie! J’ai la tête comme un compteur au bout de deux heures.
Lorsque l'erreur est enfin corrigée, Laurent se rend compte en vérifiant le papier de l'importation temporaire, qu'il manque deux chiffres au numéro de châssis de la moto. La fonctionnaire responsable, rechigne à éditer un nouveau document. On rêve ! Elle nous dit : « C'est pas grave, Señor, le douanier ne vérifie que l'immatriculation !». Ok, Señora, mais en sortant du Panama, on fait comment avec un numéro de châssis erroné ?». Laurent doit batailler pour qu’elle accepte enfin de corriger son erreur.
Il est 14h30 c’est l’heure de pointe, et maintenant il faut attendre la vérification des bagages. Depuis un moment j’observe les voitures passer à la fumiginisation. Ce n’est pas comme d’habitude, un coup de pschitt sur les roues, là il faut traverser un hangar où un vaporisateur géant asperge les véhicules d’insecticide. Il est même obligatoire de fermer les vitres, c’est écrit en gros sur le panneau. Un militaire nous fait signe de nous engager dans la file. Nous refusons tout net d’entrer là-dedans en moto : « No tenemos ventanas ! » Et c’est toujours ça d’économisé.
On accroche sur la sacoche, un petit drapeau que j’ai chipé à la frontière, la moto bat maintenant pavillon panaméen.
Nous traversons le très élégant pont des Amériques en arrivant à Panama City. Il fut longtemps le seul à enjamber le canal, mais depuis 2005, le pont Centenaire et ses six voies est ouvert à la circulation.
Laurent est en contact avec une Guest house « Panama Passage », spécialisée dans l’hébergement des voyageurs avec leurs véhicules, en particulier les motos, qui veulent passer en Colombie. Le propriétaire propose des contacts et des prix préférentiels avec une compagnie cargo. On trouve l’adresse facilement mais il n’y a personne. C’est un simple pavillon dans un quartier d’expatriés qui fait office d’hôtel. Pas d’enseigne, seule la présence de quelques motos garées sous un préau nous confirme que nous sommes au bon endroit.
En réalité, le propriétaire, qui ne l’est pas vraiment, loue la maison que le véritable propriétaire veut récupérer. Le vrai locataire est absent et laisse les rennes à un copain, très sympa, mais qui n’est pas très au courant du business…Ouh la la ça sent le tuyau percé !
Heureusement Laurent ne compte sur personne et organise notre transfert en Colombie, en étudiant toutes les possibilités. En effet, il n’y a pas de communication terrestre entre le Panama et la Colombie, les solutions pour passer sont maritimes ou aériennes. Plusieurs propriétaires de bateaux se sont spécialisés dans ces traversées car il n’existe pas non plus de compagnies officielles.
Trois motards sont là, qui ont déjà réservé un vol pour Bogota. On apprend que Yarek est parti en avion voilà quelques jours, que les anglais, les australiens et nos Jess’s ont choisit les voiliers Stalhratte et Fritz the Cat, qui malheureusement sont déjà au complet.
Au final, on fait affaire avec un nouveau bateau, « l’Independence » par l’intermédiaire d’un patron d’hôtel de Portobello, le port d’attache du voilier. Le départ est prévu dans deux jours, le 9 novembre. Sans avoir rien réservé, nous serons les premiers motards de tout le groupe du Nicaragua à toucher les côtes de Colombie ! Trop fort !
En prime, notre voilier jettera l’ancre dans les Iles San Blas, qui sont parait-il paradisiaques.
Maintenant qu’on sait où, quand et comment, on va rejoindre la Colombie, on part l’esprit serein à la découverte de Panama City.
Il nous faut surtout trouver un magasin Sony. Car en déchargeant les photos du nouvel appareil sur l’ordi, on s’est rendu compte avec horreur que tous les clichés sont barrés de lignes verticales multicolores et que la fonction « panorama assisté » ne fonctionne pas. Toutes les photos prises au Costa Rica sont inutilisables. Quelle galère !
On fonce à Panama City, pour changer l’appareil. Le vendeur nous explique calmement qu'il peut éventuellement l’envoyer en réparation sous 15 jours mais en aucun cas le remplacer...C'est la LOI Sony. On lui demande s’il prend en charge les 15 nuits d’hôtel ?
En résumé, on achète un produit de la marque, on sort du magasin, on se rend compte qu'il ne fonctionne pas, eh bien on l’a dans le baba ! Il ne sera pas échangé mais il sera, peut être réparé ! J'ai vu passer des poignards dans les yeux de Laurent. Aussitôt, il contacte par mail, le service après-vente français qui nous donne le nom d’un correspondant Sony Amérique du Sud. S’en suivent plusieurs coups de fil en anglais et en espagnol avec divers interlocuteurs de plus en plus hauts placés, qui n’apportent pour le moment aucune solution acceptable. Nous devrons régler ce problème plus tard, en Colombie, on aura plus de temps. En revanche, la garantie ne sera pas valable dans les autres pays d’Amérique du Sud.
Sony affiche sa pub sur des panneaux 4x3 « Make Believe », « Faire Croire » Tu parles d'un slogan !
Nous avons toute une journée pour découvrir Panama City.
Cette ville est incroyable.
Située entre deux continents et deux océans reliés par le fameux canal de Panama, enjeu économique colossal, elle est à cheval entre deux mondes. On passe sans transition de quartiers très pauvres, jonchés d’ordures, aux quartiers « d’affaires » où les buildings poussent comme des champignons. Panama City est en plein essor économique et construit son avenir. Après avoir constaté que la plupart des tours étaient inoccupées, nous apprendrons que ces constructions servent en réalité au blanchiment d'argent du narcotrafic.
Les américains ont longtemps maintenu leurs bases au Panama, car impliqués financièrement dans la construction du Canal sous la présidence de Roosevelt. En 1989, l'armée américaine déploie 26 000 hommes et chars pour faire tomber le régime despotique du général Noriega, et assurer la sécurité de l'exploitation du Canal.
Depuis 1999, les américains ont transféré la gestion du canal aux autorités panaméennes et fermé leurs bases militaires.
Le dollar est resté la monnaie la plus officielle, même si le balboa tente de s'imposer.
Le Casco Viejo, le vieux quartier historique de la ville reconstruit après la destruction de Panama par le pirate Morgan, est en phase de réhabilitation. Les prix flambent et les habitants des quartiers rénovés ne pourront pas continuer à y vivre. On se dit que dans 10 ans, ou moins, tout sera bien différent !
Sur un marché, quelques indiens Kuna vendent leurs travaux de broderies.
Le contraste est fort entre les immeubles vétustes, insalubres et populaires et les jolies façades des bâtiments officiels, comme ceux de la Plaza de Francia et des quartiers branchés.
Du Malecon, on a une vue fabuleuse sur la baie. Des barques de pêcheurs y sont amarrées et le soir, lorsque le soleil décline, il éclabousse d’or les tours vitrées du nouveau quartier d’affaires.
Tout à fait par hasard, nous rencontrons les Jess’s en moto. Ils sont arrivés du matin et prennent le bateau un jour après nous. Nous les suivons à leur hostel dans le centre historique. Un vieux bâtiment sur plusieurs niveaux où il règne une joyeuse effervescence cosmopolite qui contraste avec le calme de notre guesthouse. Une véritable ruche ! Il a au moins cent personnes, la plupart de jeunes backpackers baba cools. Nous buvons une bière en nous racontant nos dernières péripéties et nous nous donnons rendez-vous à l’hostel de Portobelo dans deux jours.
Impossible de quitter le Panama, sans aller voir de plus près le canal.
Il relie l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes.
Commencé en 1880 sous la direction de Ferdinand de Lesseps, fort du succès du canal de Suez, le chantier fût terminé par les Etats Unis en 1913 après avoir emporté environ 27 000 travailleurs, qui tombaient comme des mouches, tués par le paludisme, la fièvre jaune ou les inondations pendant la saison des pluies.
Aujourd'hui, un cargo met environ 9h pour parcourir les 77kms du canal, qui comprend un complexe d'écluses, dont les fameuses écluses de Miraflores et de lacs artificiels.
De gigantesques tankers et porte-containers, empruntent le canal quotidiennement.
Toute traversée du canal est taxée. La plus chère, $250 000 payés par un porte-containers en 2006 et la moins élevée, 36 cents payés par un aventurier américain qui l'a traversé à la nage en 1928.
Nous partons pour Portobelo, sur la côte Caraïbes. Une violente averse nous trempe jusqu'aux os malgré l'équipement. C’était comme rouler dans un lavo-jet. Réfugiés sous un abri bus, je me dis qu’il est impossible que tout soit sec avant notre départ en bateau demain matin. Je garde ces réflexions pour moi, car je sais que Laurent n’en a absolument rien à faire d’enfiler des vêtements qui sentent le moisi.
Nous déposons nos sacs avec le nécessaire pour la nuit à l’Hostel « Captain Jack’s ». Le patron nous dit de filer sur la plage à une dizaine de kilomètres de là pour l’embarquement de la moto avant la nuit. Il nous faudra ensuite revenir par nos propres moyens.
L'aventure commence sur le sable. Nous ne sommes pas seuls, un grand gaillard blond pas très causant en Kawasaki KLR, a déjà allégé sa moto, en retirant les bagages et tout ce qui dépasse. Laurent démonte la bulle, et les valises alu. Il bruine. Un grand voilier bleu amarré dans la baie se balance doucement. On se dit que c’est surement notre bateau. Une lancha, grande barque en bois traditionnelle, accoste sur la plage et quatre gros bras, qui ressemblent plus à des gangsters qu’à des marins, chargent en quelques minutes le KLR et son pilote. Un grand black, sosie de Mister T s’assoie dessus et la maintient pendant la traversée. Nous attendons patiemment qu’ils reviennent nous chercher. Le jour décline très vite. Lorsqu’à notre tour nous atteignons le voilier, il fait nuit noire. Un treuil permet de hisser la moto sur le 2ème pont à l'abri des projections d’eau de mer. Une fois sanglée, on a un petit stress, en voyant la moto s'élever au dessus de nous. Elle est récupérée sur le pont supérieur et solidement arrimée de façon à ne pas bouger. Elle n'est pas à plaindre, la vue est belle et dégagée, et elle voyagera en compagnie d'une copine. Le capitaine, qui jusqu’à présent faisait plutôt des croisières chics, inaugure avec nous le transport de motos.
Nous remontons dans la lancha avec nos molosses qui nous ramènent sur la plage. C’est un peu surréaliste, il fait nuit, nous sommes dans une barque à moteur dans les Caraïbes avec quatre types patibulaires, on a l’impression de faire de la contrebande. L’un deux nous propose d’attendre chez lui le taxi qui n’arrivera que dans une heure. Il habite une maisonnette en dehors du village et héberge des candidats à la traversée. Nous buvons une bière avec des gens, dont deux russes un peu louches qui ont des têtes de tueurs. D’ailleurs, leurs sous-entendus et leurs regards de connivence me font dire qu’ils ne sont pas très clean. Enfin de retour à Portobelo, nous retrouvons nos Jess’s et leurs visages honnêtes tout juste arrivés.
C’est la dernière soirée sur la terre ferme du Panama au « Captain Jack’s » dont l’emblème est une tête de mort. Laurent est en terrain connu, il a la même sur ses tee shirts, et avec son bandana noué sur la tête, il pourrait même servir d’enseigne à l’hôtel.
A nouveau, nous partageons le dortoir avec nos Jess’s, au beau milieu d’un joyeux bazar de blousons, de pantalons, de gants et de casques trempés.
Transat pour la Transam
Tôt le matin, nous faisons la connaissance de nos compagnons de voyage dans la barque à moteur qui nous conduit sur le yacht. De jeunes allemands, deux hongroises, Henrick, le motard polonais vivant en Australie, Marcio, brésilien, Fernando, argentin. Laurent pour une fois, ne maitrise rien et surtout, va faire son baptême maritime !
L'équipage se compose de Captain Michel, et ses « drôles de dames » colombiennes. Paola, Tatiana et Majo, la petite amie de Michel, qui à mon avis pourrait facilement être son grand père, sans oublier le Berger Allemand que j'ai baptisé « Brutus » vu le sourire carnassier dont il nous gratifie, tout ce petit monde nous accueillent à bord.
Les filles sont des amours, quand ça va et même quand ça ne va pas !
En revanche le chien est une terreur, né sur le bateau, il n'est jamais descendu à terre, le pont avant est son territoire. Il sert de (grosse) sonnette d'alarme. Michel nous explique qu’un voilier est toujours une cible de choix pour les pirates ! Gloupss !
« L'Independence » est un grand bateau de 25m de long. Le capitaine est fier de dire que tous pleins faits, carburant, nourriture, eau, ce bateau et son équipage peuvent vivre cinq ans (à l'économie) sans ravitailler... Déjà que cinq jours ça a été un peu long pour certains...
Le Cap’tain nous fait les honneurs du bateau. Dans la coque, il y les cabines, spacieuses équipées de salle de bain et de toilettes. Celle qu’il nous attribue a même l'air conditionné...Mais pas tout le temps ! Le mobilier est un peu tape à l’œil, lit king size, statuettes de gentilshommes en imitation bronze surmontées d’abats jours galonnés en guise de lampes de chevets et tapis chinois. Elle est si grande qu’un des passagers la partagera avec nous et couchera sur un matelas posé sur le plancher.
Il y fait très chaud, ajouté aux mouvements du bateau et aux odeurs de gasoil, ça nous brasse un peu l'estomac.
1er pont, cuisine, domaine de Tatiana, carré spacieux, et appartements privés du Capitaine, de Majo et de Brutus.
Pont supérieur, poste de pilotage où se relaient le capitaine et « ses secondes » Paola et Majo. Une grande table, des transats, des banquettes et les motos qui empiètent un peu sur la surface habitable. Nous sommes seize à bord.
La croisière débute par un cabotage le long des côtes panaméennes. Laurent a encore le sourire, mais ça ne va pas durer !
Dès le bateau sorti de la baie, les premiers roulis et tangages ont raison de son estomac et de sa bonne humeur. Sa position de sécurité, allongé sur le pont les yeux fermés. Petite variante possible, Metallica à fond dans les oreillettes !
L'activité à bord étant réduite au strict minimum, on a le temps de paresser dans les transats, doigts de pieds en éventail, réviser son guide de voyage, mettre en pratique les cours de self-défense dispensés par le capitaine. L’une des hongroises est très motivée pour le corps à corps n’est ce pas mon amour ! J’espère que ça lui sera utile. J’apprends à faire de jolies sauterelles en feuille de palme avec Sacha, un passager qui a toutes les aptitudes requises pour devenir un excellent moniteur de colonies de vacances.
Le temps est rythmé par les repas. Moment critique s’il en est, car pour ces jeunes gens le mot « partage »ne fait visiblement pas partie de leur vocabulaire. Ils sont les plus rapides à plonger les fourchettes dans le plat, mangent sans se soucier des autres, se resservent sans complexe avant même d’avoir terminé leur première fournée ! Le matin, gare à celui qui tarde à se lever, ce qui obligera le Capitaine à les recadrer fermement.
Tous vissés sur leur chaise, pas un ne bouge pour débarrasser la table et passer la vaisselle en cuisine. On ne va pas se fâcher...Il n'y a que cinq jours à passer à bord. Sinon, en dehors de ça ils sont charmants !
On fera même une soirée dansante tous ensemble, détendus par quelques verres de Cuba libre.
Les deux premiers jours, le bateau navigue dans l'archipel des San Blas, 365 ilots coralliens dont seule une soixantaine est habitée. Le Cap’tain jette l'ancre et nous descendons à terre avec le dinky, l’annexe du bateau. Nous jouons les robinsons sur ces îlots paradisiaques de sable blanc, plantés de cocotiers. Certains ne font que quelques m², d'autres sont habités par les indiens Kuna. Ils vivent dans des huttes primitives, en bambou et toits de palmes. Ils pêchent et font du commerce avec les nombreux plaisanciers qui viennent s’abriter dans leurs eaux calmes, en s’acquittant d’une sorte de péage.
L’archipel est bien protégé par les récifs coralliens qui affleurent. Il y a deux ou trois épaves qui l’ont expérimenté à leurs dépens. Les eaux turquoise transparentes laissent voir des centaines d’étoiles de mer géantes, et des coquillages nacrés à quelques mètres du rivage. Une fillette, curieuse et souriante s’approche de nous. Visiblement elle a l’habitude de côtoyer les étrangers, car très vite elle devient notre meilleure amie.
Elle s’appelle Amélia, elle a 6 ans. Elle passe son temps sous l’eau mais ne sait pas nager. On entreprend de lui apprendre les bases de la brasse. Elle rit aux éclats et me presse de la tenir sous le ventre pour perfectionner la coordination de ses mouvements.
Laurent qui trouve toujours un truc pour me faire rire, se tartine le corps de sable et entreprend une petite séance peau douce. Sauf que ça lui tire les poils à mon grizzli !
Pendant qu’il fait une fabuleuse expérience sous-marine, dans cet aquarium géant, au milieu d'une forêt de coraux où vivent des milliers de poissons multicolores et lumineux, je me promène sur ce qu’il est convenu d’appeler un paradis terrestre. Je profite de ces moments de calme avec délectation. Pas de route, pas de pistes, pas de stress. Juste le sable, les cocotiers, les alizés et moi.
Le Cap’tain, améliore l’ordinaire en pêchant à la traine. Une magnifique daurade d’un vert presque fluorescent a changé de couleur lorsque la vie l’a quittée, une fois sur le pont. Un indien Kuna, nous aborde en nous proposant les langoustes qu’il vient de pêcher. Il en a au moins une vingtaine dans le fond de sa barque. Elles sont énormes, l’une d’entre elles est trois fois plus longue que mon pied ! Chaque passager fait son marché. Tatiana fait bouillir les bestioles vivantes. Et en quelques heures, elles passent du fond de l’océan à notre assiette. Pas cool pour elles, mais un super souvenir pour nous !
C’est la dernière soirée dans les îles, fini les cocotiers. Demain matin on lève l'ancre à 6h, et nous voguerons durant trente heures non-stop jusqu'en Colombie.
Au matin, accroché au matelas de notre lit comme des berniques à leur rocher, on n’ose à peine ouvrir nos yeux bouffis. Le yacht avance au moteur depuis le début de la nuit. Nous subissons un grain qui brasse le bateau autant que nos estomacs. La climatisation est coupée, car toute la puissance est nécessaire pour lutter contre les vents. Il fait une chaleur torride dans la cabine et les effluves de carburant nous soulèvent le cœur. Je regarde par le hublot, un coup je vois le ciel, un coup je vois le fond de l’eau…
Tant bien que mal j’arrive à me hisser sur le pont, respirer un peu d’air frais. J’essaie de fixer un point à l’horizon pour m’aider à lutter contre le mal de mer, mais on ne voit rien que d’énormes vagues et le bateau qui saute comme un bouchon au milieu de cette masse noire. Sur le pont, des petits oiseaux perdus en mer, ont trouvé refuge à bord. Ils sont si désorientés qu’ils se laissent caresser et capturer. Le Cap’tain les met dans une petite cage suspendue. Il dit qu’il les relâchera plus tard en arrivant. Mais nous les retrouverons morts le lendemain matin.
A l'aube du 5ème jour, les côtes de la Colombie sont en vue. Nous entrons dans le port de Cartagena vers 13h et jetons l'ancre pour la dernière fois dans une baie magnifique, parmi de splendides voiliers et hors bord de luxe. Le long de la baie, les mêmes buildings flambants neufs qu’à Panama City, et tout aussi déserts !
Sur la gauche, nous apercevons la muraille d’enceinte protégeant la ville coloniale et les coupoles colorées des églises.
A droite, le port de commerce et ses docks encombrés de milliers de containers multicolores empilés comme des légos.
Le Cap’tain n’a pas d’autorisation pour accoster dans le port. Il doit rester à l’ancre dans la baie.
Il n’y a qu’une solution, descendre les motos dans le dinky.
Après avoir étudié les différentes possibilités, Laurent décide de coucher la moto dans le dinky,en l’appuyant sur un pare battage, car contrairement à la lancha, la coque est plate et peu profonde. Maintenir la moto debout pourrait s'avérer périlleux.
Laurent est dans le dinky tandis que sur le pont trois garçons l’arriment, et la font lentement descendre le long de la coque. Tout ce passe bien, mais c’est très impressionnant.
Une fois arrivés à quai, la monter sur le ponton est facile. Le KLR suit le même chemin une demi-heure plus tard.
Bravo les garçons, c'est du bon boulot !
Sur un quai de Cartagena, le jour décline, il est temps de trouver un hôtel pour la nuit. Toute la bande de backpackers va dormir au même endroit. Nous préférons prendre un peu de distance après ces jours de cohabitation.
Nous sommes le 13 novembre, un samedi, les formalités douanières devront attendre mardi, car c'est la fête de « l'Independencia » de la ville... Et la fiesta en Colombie, c'est sacré !!!